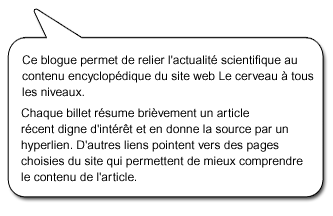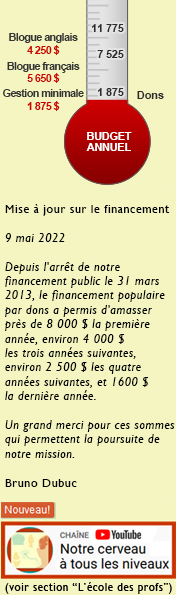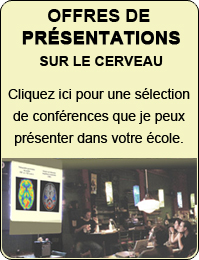lundi, 19 octobre 2015
Ces molécules qui nous font courir
 Qu’est-ce qui relie le besoin de faire du sport, le plaisir que cela procure, et l’impératif de survie de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs ou même des premières formes de vie animale ? Comme toujours en biologie, la fixation de certaines molécules sur leur récepteur joue ici un rôle de premier plan, comme le confirme une fois de plus les deux études dont il sera question aujourd’hui.
Qu’est-ce qui relie le besoin de faire du sport, le plaisir que cela procure, et l’impératif de survie de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs ou même des premières formes de vie animale ? Comme toujours en biologie, la fixation de certaines molécules sur leur récepteur joue ici un rôle de premier plan, comme le confirme une fois de plus les deux études dont il sera question aujourd’hui.
Mais juste avant de les résumer, rappelons-nous que l’on peut toujours apporter deux réponses au genre de question qui introduit ce billet : distales et proximales. Les causes distales sont les raisons ultimes, en termes d’évolution, qui nous poussent à agir. Dans le cas présent, ce qu’il faut voir, c’est que faire du jogging aujourd’hui est l’équivalent de traquer du gibier ou de chercher des arbres fruitiers à l’époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c’est-à-dire durant plus de 99% du temps qu’a duré l’hominisation (quelques millions d’années) comparé à l’Histoire humaine depuis l’invention de l’écriture ou même le début de l’agriculture il y a 5 ou 10 000 ans. Et donc durant tout ce temps, une pression sélective s’est opérée qui a fait en sorte que les individus qui n’étaient pas suffisamment motivés pour se botter le derrière et courir dans le froid après leur prochain repas n’ont pas laissé beaucoup de descendants ! Par conséquent, nous sommes, nous, les descendants des plus motivés parce que probablement aussi les plus euphoriques et relaxes après leur chasse fructueuse. Et ce sont donc leurs gènes dont nous avons hérités.
De son côté, le niveau d’explication proximal est celui des mécanismes et des motivations perçues qui nous poussent aujourd’hui à agir. Dans le cas de la pratique sportive, c’est le souvenir du bien-être euphorique qu’il apporte qui nous convainc de chausser nos chaussures de course même s’il commence à neiger dehors. Et cette motivation basée sur le souvenir d’un plaisir anticipé, on commence à en connaître des étapes clés au niveau moléculaire.
On a ainsi découvert il y a un bon demi-siècle ce qu’on a d’abord appelé le faisceau de la récompense ou du plaisir (MFB, en anglais à l’origine) et qui s’est ensuite complexifié en un réseau comportant de nombreuses structures cérébrales dont le cœur est le circuit reliant l’aire tegmentale ventrale au noyau accumbens, mais qui implique également plusieurs autres régions comme l’amygdale ou le cortex préfrontal. Des travaux récents, comme ceux de Salah el-Mestikawy et ses collègues décrits dans le premier lien ci-dessous raffinent notre compréhension en s’intéressant à une classe particulière d’interneurones du noyau accumbens. Ces interneurones utilisent deux neurotransmetteurs, l’acétylcholine pour augmenter la sensation de plaisir et le glutamate pour la diminuer. Ceci montre comment les choses peuvent être plus complexes que l’ancienne vision des choses où un neurone utilisait un seul neurotransmetteur et était considéré comme excitateur ou inhibiteur selon la nature de ce neurotransmetteur. On a ici, par exemple, du glutamate, neurotransmetteur excitateur par excellence dans le cortex, qui produit une inhibition !
Mais revenons aux deux mécanismes moléculaires dont je voulais vous parler (c’est tellement facile d’être happé par la complexité du cerveau…). Le premier aide à comprendre pourquoi on a le goût de s’extirper de notre confort pour aller faire du sport et le second pourquoi on se dit après (et qu’on va se rappeler) qu’on a bien fait.
C’est dans le même premier lien ci-dessous qu’un encadré expose le mécanisme par lequel nos cellules adipeuses sécrètent une hormone, la leptine, qui lorsqu’elle se fixe sur des récepteurs que possèdent les neurones de l’aire tegmentale ventrale, va amener ceux-ci (par une chaîne biochimique remontant jusqu’au gène STAT3 dans le noyau de ces neurones) à relâcher moins de dopamine dans le noyau accumbens. On a donc un mécanisme qui a son origine dans nos cellules adipeuses (nos réserves de gras) capable de moduler notre faisceau du plaisir. Comme l’explique Stephanie Fulton qui travaille sur ce mécanisme, on a là un mécanisme capable de renseigner le cerveau sur les réserves énergétiques stockées dans le gras de notre corps. Et quand ces réserves sont suffisantes, la leptine va diminuer l’urgence de se nourrir mais aussi la motivation à courir, activité qui fut longtemps associée à la marche ou la course nécessaire à la recherche de nourriture.
Les souris dont l’action de la leptine a été désactivée par manipulations génétiques choisissent donc d’aller courir dans une roue plus souvent que les autres. Et des études antérieures ont montré que les athlètes obtenant les meilleurs temps au marathon ou les gens qui font de l’exercice de façon compulsive étaient aussi ceux qui présentaient les plus bas taux de leptine. Des taux parfois même plus bas que ceux qui devraient correspondre à la quantité de tissu adipeux de leur corps, ce qui pourrait expliquer en partie leur envie irrépressible de faire du sport.
L’autre étude, celle de Johannes Fuss et ses collègues, remet en question le rôle prédominant que l’on attribue habituellement aux endorphines dans le sentiment de bien-être suite à la pratique intense d’une activité sportive. Le « runner’s high » (expression anglaise consacrée pour décrire ce phénomène) est en fait composé de plusieurs phénomènes concomitants dont le sentiment d’euphorie, une baisse d’anxiété, une analgésie à la douleur et un effet sédatif d’apaisement.
Or l’exercice augmente le niveau sanguin des bêta-endorphines mais également de l’anandamide, une substance endocannabinoïde (notre analogue naturel au THC du cannabis). En utilisant différentes technique, l’équipe de Fuss a pu montrer chez la souris que ce sont les récepteurs de l’anandamide qui sont responsables de la baisse d’anxiété et de l’analgésie à la douleur. Plus précisément, la baisse d’anxiété serait liée à la présence des récepteurs CB1 de l’anandamide dans les neurones au GABA du cortex préfrontal, alors que la réduction de la douleur serait quant à elle associée à l’activation de récepteur CB1 et CB2, mais dans le système nerveux périphérique cette fois.
Des résultats qui confirment pourquoi des subtances végétales dont la forme coïncide avec certains de nos récepteurs naturels (les opiacés pour les récepteurs aux endorphines, le THC pour nos récepteurs à l’anandamide) ont un effet psychotrope. Et pourquoi on peut réellement parler d’addiction au sport. Une addiction qui a des origines évolutives anciennes qui se sont avérées fort bénéfiques. Et qui, si elle n’est pas excessive comme le montrent d’innombrables études, le sont encore aujourd’hui parce qu’on a essentiellement le même corps et le même cerveau !
![]() Prisonnier de sa dépendance & Le plaisir de courir
Prisonnier de sa dépendance & Le plaisir de courir
![]() A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice
A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice
Dormir, rêver..., Non classé | Comments Closed